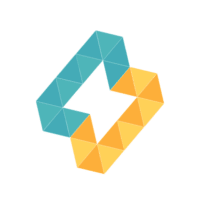Sur chaque tournoi, il y a un moment où la tension monte d’un cran. Les cartes se resserrent, les scores sont scrutés, et la moindre erreur peut coûter cher. Les joueurs le savent : le week-end ne sera pas pour tout le monde après le cut. C’est l’instant où le tournoi change de visage, où la compétition se concentre sur ceux qui peuvent réellement prétendre à la victoire. Dans le golf professionnel comme dans de nombreuses compétitions amateurs, ce passage décisif fait partie intégrante du spectacle et du jeu. Il rythme le tournoi, impose sa pression, et forge parfois des légendes, quand un joueur sauve sa place à la dernière minute ou échoue d’un seul coup. Comprendre ce mécanisme, c’est plonger au cœur de la stratégie et des enjeux qui façonnent chaque événement.
Qu’est-ce que le cut ?
Le cut au golf désigne ce moment décisif, généralement à mi-tournoi, où une partie du champ de joueurs est éliminée, et seuls les meilleurs poursuivent les derniers tours. En français, on parle aussi de “couperet”, “seuil de qualification” — mais dans le monde du golf, le terme cut reste le plus utilisé. C’est un outil structurel essentiel : entre gestion du temps, équité (sélection des joueurs réellement en lice), spectacle, enjeux pour les primes et le classement.
Le principe est simple en apparence. Mais dans la pratique, il varie selon les circuits, les compétitions, selon qu’on est amateur ou professionnel.

A quel moment intervient-il ?
Typiquement après les deux premiers tours (36 trous) dans les tournois quatre jours. Parfois , le cut peut être différent en fonction du format de compétition ou du circuit (champ de joueurs réduits, compétition fédérales amateurs…).
Qui est concerné
Tous les joueurs inscrits (professionnels, amateurs selon le tournoi) participent aux tours de qualification. Au cut, on retient un nombre défini de joueurs, plus les ex aequo (ceux dont le score est égal à celui de la dernière place autorisée).
Ceux qui ne passent pas le cut ne jouent pas les jours suivants. Ils ne peuvent pas concourir pour le titre, et selon le tournoi, ils peuvent ne pas toucher de prime ou part de gains.
Comment se fixe le seuil d’élimination
Le couperet dépend :
- Du nombre initial de joueurs.
- Des règles spécifiques du circuit ou de la compétition.
- Du classement après les deux premiers tours : le cut correspond au score du joueur qui se retrouve à la dernière place autorisée (et tous les ex aequo).
- Pour les “majeurs” ou autres tournois prestigieux, il peut y avoir des règles particulières (nombre de joueurs, ou seuils autres, ou en plus la règle “10 coups derrière le leader” pour une plus grande sélectivité).
Le cut : un stress de plus à gérer pour les compétiteurs
En réduisant le nombre de joueurs pour les tours finaux, il facilite la logistique, améliore le rythme de jeu, renforce la visibilité de l’événement et optimise la diffusion télévisée. Mais pour les joueurs, il représente surtout une véritable épreuve : chacun doit “gagner sa place” pour le week-end, ce qui crée une tension palpable, source de stress et de suspense.
Pour les professionnels, franchir le cut signifie non seulement rester en lice pour le titre, mais aussi assurer une part à la dotation financière.
À l’inverse, ne pas le faire est vécu comme une contre-performance, avec des conséquences sportives et pécuniaires non négligeables.

Le cut dans les compétitions professionnelles : règles, et variantes
Pour mieux comprendre, voici les applications concrètes dans le monde pro, avec des cas différents.
Les circuits classiques (PGA Tour, DP World Tour LPGA, Ladies European Tour…)
- Sur les tournois du PGA Tour, les organisateur applique la règle du Top 65 et ex aequo après 36 trous.
- Sur le DP World Tour (anciennement European Tour), des règles similaires sont appliqués. Seuls quelques tournois, comme l’Alfred Dunhill Links Championship, appliquent des variations selon l’événement.
Les Majeurs
Au nombre de 4 (The Masters, The Open, US Open et PGA Championship), ces tournois nous propose ce qui se fait de mieux dans le golf mondial.
Pour autant, le premier objectif pour les participants reste le même : passer le cut pour jouer le week-end. Avec une pression en plus compte tenu des grosses dotations financières promises au vainqueur et des gros points à gagner pour les classements.
Mais chaque majeur a ses propres particularités :
- The Masters : seules les 50 premières positions et les ex aequo poursuivent les derniers jours. La règle “10 coups derrière le leader” a existé dans le passé mais a été supprimée en 2020.
- US Open : le top 60 et les ex aequo ont la chance de pouvoir continuer à jouer le week-end.
- PGA Championship : la règle du top 70 et des ex aequo s’appliquepour le cut.
- The Open Championship (British Open) : comme pour le PGA Championship, ce sont le top 70 et les ex aequo qui pourront se disputer le victoire le dimanche.
Des variantes particulières
Il existe des tournois “sans cut” (no-cut events). Certains tournois, souvent avec un champ limité ou uniquement sur invitation, n’ont pas de cut. Tous les joueurs jouent tous les tours. Cela peut faciliter le planning, mais supprime la tension du cut. C’est aussi le cas des tournois du Liv Golf Tour, où les organisateurs ont fait le choix d’un format singulier pour dynamiser le format des compétitions : 13 équipes de 4 joueurs qui s’affrontent sur 54 coups, sans cut, avec un départ en shotgun chaque jour.
Les Playoffs des différents Tours se jouent eux aussi sans cut. La sélection se fait en amont via un champ de joueurs restreints en fonction du classement.
D’anciennes règles donnent la possibilité d’un double cut. Si après le cut standard trop de joueurs restaient encore en lice, un second cut pouvait être appliqué après le 3ᵉ tour. Mais cela tend à disparaître.
Le cut en compétition amateur, en France, lors des compétitions fédérales

Le monde amateur a ses propres usages du cut : plus flexibles, moins rigides en termes d’argent, souvent plus de diversité selon les niveaux, catégories, lieux.
Pourquoi un cut dans les compétitions fédérales amateur
Les grands prix fédéraux sont ce qui se fait de mieux dans le golf amateur français. Alors quoi de plus normal que l’on se rapproche au maximum de ce qui se fait dans le monde professionnel, en terme d’organisation, de difficulté de parcours, mais aussi sur l’aspect mental.
Mais le cut reste avant tout un outil utile pour :
- Limiter la durée des parties, la fatigue des joueurs, et le temps nécessaire à tous.
- Distinguer les joueurs réellement en jeu pour le classement principal (prix, distinctions, championnats).
- Maintenir l’équité, cadrer le déroulement, respecter les contraintes logistiques du parcours, du club, des arbitres.
Comment s’applique t’il
Dans les Grands Prix fédéraux, le cut est généralement appliqué après 18 trous. Le nombre de joueurs retenus dépend du nombre de participants et de ce que le club et la fédération veulent comme effectif pour le dernier jour.
Comme pour les compétitions professionnelles, le seuil peut être “les N meilleurs et les ex aequo”. Par exemple, les 50 meilleurs et ex aequo. Mais les organisateurs peuvent aussi faire un autre choix, comme réduire le champ de moitié.
Du fait de la grande diversité des participants, il arrivent que la barrière des éliminations soit plus souple, intégrant la notion de série amateur.
Conséquences pour les golfeurs amateurs
Le statut de golfeur amateur limite les gains que peut gagner un compétiteur. Même s’il participe à un tournoi professionnel, un golfeur amateur ne peut pas percevoir une somme au-delà de 850€. Cela inclut la dotation proprement dite, mais aussi la valeur de tout lot que pourrait recevoir la personne concernée, à l’exception d’un trophée.
Il est donc pas ou peu question de primes d’argent dans les compétitions fédérales, d’autant plus qu’à ma connaissance, aucune d’entre elles à ce jour ne dote les golfeurs en récompense financière.
Le cut est avant tout une question de motivation dans le golf amateur. Car pour beaucoup d’amateurs, le passer est déjà un objectif en soit.
Mais pour un compétiteur, cela reste une pression psychologique grisante. Chaque coup compte plus que jamais. Le moindre petit putt raté prend une importance déterminante, surtout s’il a lui dans les derniers trous du parcours.
Limites, controverses et pistes d’évolution
Le cut, bien que très utile, n’est pas sans critiques ni défis. Il n’y a qu’à voir ce qui s’est passé sur le Liv Golf.
Voici quelques discussions sur le sujet :
L’équité facile à assurer selon les conditions
Comme toutes les disciplines d’extérieur, les compétitions de golf sont soumises aux aléas climatiques. Et Le fait que les joueurs jouent à des moments différents au cours de 2 premiers tours (matin et après-midi) peut avantager ou désavantager selon l’heure du tee-time.
Pour les amateurs, les parcours peuvent aussi varier en terme d’état. Car même si dans les grands prix, nous avons la crème de la crème en terme de golf, cela peut laisser à désirer en terme de capacité à réparer le parcours. Et quoi qu’on en dise, il est fortement dérangeant de jouer un coup dans un divot, putter sur des greens lourdement piétinés ou tomber dans une trace de pas dans un bunker. Et quand je vous dis cela, cela sent le vécu !
L’effet négatif sur les “petits joueurs”
Dans le monde professionnel, les écarts en terme de gains lors des compétitions sont vertigineux. Si on prend le PGA Tour, entre le 1er et le 100ème, il y a plus de 26 millions de dollars de différence.
Au delà de la 125ème place de la money list, les joueurs gagnent moins de 950 000 dollars. Sans compter le stress de ne plus avoir de catégorie de jeu pour la saison suivante !
Cela peut paraître confortable. Mais lorsque l’on voit les frais que les golfeurs ont à engager (droits de jeu, frais de déplacement, honoraires de coaching, frais médicaux, rémunération du caddie…), les dotations financières offertes par les sponsors sont plus que bienvenus.
Car pour un professionnel, pas de cut = pas d’argent gagné !
Recommandations & bonnes pratiques
Si on organise une compétition ou si l’on y participe, voici des idées pour que le cut serve au mieux les intérêts sportifs, du public, du jeu :
- Transparence des règles : les joueurs doivent savoir à l’avance comment le cut sera fixé (nombre de joueurs, ex aequo, horaires…).
- Conditions justes : essayer de minimiser l’impact des heure de départ, météo, état du parcours. Par exemple, équilibrer les tee-times matin / après-midi dans le deuxième tour.
- Communication du “cut line” en temps réel : les joueurs doivent voir à quel score ils doivent arriver pour passer le cut — cela crée du suspense, mais aussi de la stratégie.
- Encourager les joueurs “on the bubble” : derniers trous, stratégie pour ces joueurs souvent différente ; cela peut rendre le tournoi plus intéressant.
- Proposer des récompenses “améliorées” même pour ceux qui manquent le cut (dans certaines compétitions amateurs, symboliques mais valorisantes).
Vers des compétitions de plus en plus excitantes
Le cut est un mécanisme qui équilibre à la fois exigence sportive, efficacité logistique, tension dramatique. Chez les professionnels, il structure les circuits, influence les gains, façonne les carrières ; chez les amateurs, il reste un défi, un objectif, un instrument de compétition juste quand il est bien pensé.
Même si c’est une barrière mais aussi une invitation : si tu veux rester dans le tournoi, il faut jouer bien tôt, être prêt dès le début — pas juste viser le bon score, mais gérer la pression, les conditions, la stratégie.
Même si je ne suis pas tombé dans le golf en étant petit, j’avoue mettre passionné pour ce sport chronophage mais tellement addictif. Pour avoir tester de nombreuses méthodes, j’ai vite compris que l’on pouvait s’égarer si l’on ne faisait pas preuve de méthode dans entrainement. Le but reste de progresser pour prendre un maximum de plaisir sur le parcours. Etant toutes et tous différents, il est inconcevable de penser qu’il existe une méthode unique qui s’adapte à tout le monde. Le tout est de comprendre ce qui est universel et ce qui relève de la personnalisation selon votre profil de motricité !